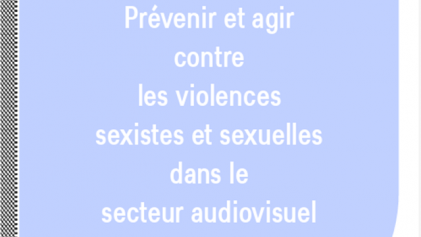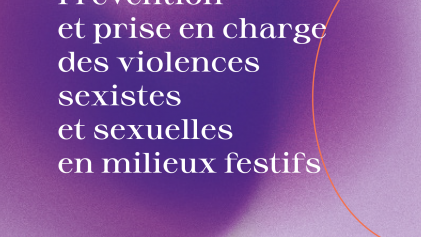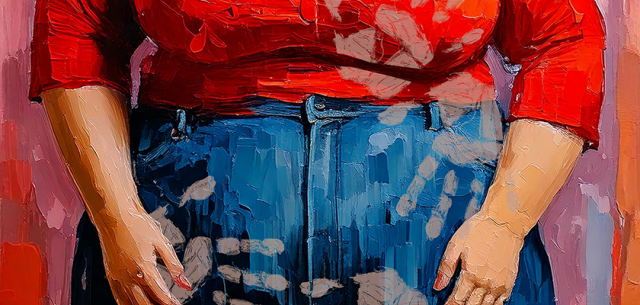Violence sexuelle
Les violences sexuelles constituent une infraction pénale. Quel que soit le genre de la victime, la grande majorité des violences sexuelles sont exercées par des hommes de tout âge, classe sociale et origine. Les violences sexuelles peuvent prendre 4 formes :
- l’atteinte à l’intégrité sexuelle
- le viol
- le voyeurisme
- la diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel
On peut donc être victime de violence sexuelle même s’il n’y a pas eu de contact physique avec l’agresseur.
De très nombreuses femmes subissent des violences sexuelles. Toutefois, des hommes peuvent également subir des violences sexuelles. Peu importe leur âge, leur classe sociale, leur origine. Ces violences peuvent entraîner des conséquences durables.
Même longtemps après, il est donc toujours temps d’agir. Et de chercher un soutien.

Violences sexuelles. De quoi parle-t-on exactement ?
« La violence sexuelle comprend toute forme de contact sexuel non désiré ». Elle peut prendre plusieurs formes dont la forme psychologique à travers le contrôle, la manipulation, l’humiliation d’une personne en lien avec sa sexualité. Il n’y a pas nécessairement de contact physique.
La notion centrale pour caractériser une violence sexuelle ? L’absence de consentement !
Ces violences peuvent avoir des conséquences à long terme sur la santé mentale et physique des victimes, leur vie sociale, sentimentale et économique. Elles peuvent se répercuter sur leur entourage, ce qui tend à les isoler et à réduire les ressources dont elles disposent.
Pourquoi de nombreuses victimes ne cherchent pas de soutien après une violence sexuelle ?
C’est souvent par peur, par culpabilité, par honte ou du fait de leur état de santé mentale provoqué par l’agression comme une amnésie traumatique , une dissociation. De nombreuses victimes vivent avec une mémoire traumatique qui se lève parfois des années plus tard.
Certains événements peuvent être propices à la levée de l’amnésie traumatique:
- les premières expériences sexuelles consenties
- une nouvelle agression
- un accouchement
- un toucher vaginal...
Que l’agression soit récente ou ancienne, la victime peut fortement améliorer sa santé mentale grâce à un accompagnement par des services professionnels formés.

Que faire face à une victime de violence sexuelle?
- Appeler le 112 s’il y a urgence médicale ou danger immédiat.
- Inviter la victime à se rendre dans un Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles, appelé CPVS, juste après les faits et idéalement dans les 78 heures. Cette rapidité permet d’avoir la prise en charge la plus efficace possible. C’est essentiel pour les risques d‘infection sexuelle, de grossesse non désirée ou pour la prévention d’un trouble de stress post-traumatique.
Les CPVS sont ouverts 24 heures/24 et 7 jours/7 et leurs services sont gratuits.
Que proposent les CPVS ?
- Un accompagnement par des personnes professionnelles formées
- Une prise en charge médicale
- Une prise en charge médico-légale avec relevé de preuves ADN
- Un appui psychologique
- Un soutien policier en cas de dépôt de plainte
Bon à savoir :
- Mieux vaut éviter de brusquer la victime et lui laisser le temps de prendre elle-même la décision de s’y rendre.
- De nombreuses victimes d’agressions sexuelles ou de viol n’en parlent que plusieurs années après.
- Les CPVS offrent une prise en charge adaptée aux victimes mineures
Dans le cadre d’une réorientation, il est possible d’encourager la victime à s’adresser à :
- des associations qui proposent un accompagnement spécialisé pour toute personne qui a subi des violences sexuelles même si les faits ont été perpétrés il y a plus d’un mois, y compris dans l’enfance
- des associations spécialisées dans l’accompagnement des enfants
des structures qui offrent des conseils juridiques.
Que faire face au témoignage incohérent d’une personne qui confie avoir été victime de violences sexuelles ?
Le personnel soignant n’est ni juge ni un membre de la police. Il n’est pas là pour juger si la personne dit vrai ou non. Le rôle d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé est d’informer la victime de ses droits et de l’orienter vers les services de première ligne .
Ce qui altère les souvenirs de la victime d’agression sexuelle
Il faut savoir que le traumatisme psychologique provoqué par l'agression peut altérer la mémoire et la perception des événements. En situation de stress intense, le cerveau peut fragmenter les souvenirs et rendre difficile la reconstitution chronologique précise. De plus, la honte, la culpabilité et la peur de ne pas être crue peuvent amener la victime à omettre ou à modifier des détails involontairement. Il est important de comprendre ces dynamiques pour apporter un soutien adéquat aux victimes et leur faciliter un parcours de reconstruction.

Vers où diriger les auteurs ou d’autres personnes qui se questionnent sur des comportements sexuels potentiellement inadéquats ?
Les services repris dans cette liste sont disponibles pour :
- répondre aux questions des professionnelles et professionnels
- aider les personnes qui se questionnent sur leur comportement
- aider les personnes qui auraient commis des actes de violence sexuelle.
Le Service d’Écoute et d’Orientation Spécialisé (SéOS)
- Site web : https://seos.be/
- Numéro de téléphone : 0800 200 99 – ligne d’écoute gratuite
- Lien direct vers le tchat : tchat gratuit et anonyme
- Adresse mail : contact@seos.be
Stop it now
- Site web : https://stopitnow.brussels/
- Numéro de téléphone : 0800 14 112
- Réseaux sociaux : Facebook (Messenger), Instagram, LinkedIn
- Adresse mail : contact@stopitnow.brussels
Groupados dédié aux mineurs auteurs de violences sexuelles et à leur famille :
- Site web : https://sos-enfants.ulb.ac.be/fr/nos-services/l-equipe-groupados
- Numéro de téléphone : 02 538 87 33, 0470 05 08 92
- Adresse mail : groupados@stpierre-bru.be
Centre d’Appui Bruxellois (CAB)
Ce centre répond aux questions des professionnelles et des professionnels sur la délinquance sexuelles. Il s’adresse donc aux assistants et assistantes de justice, thérapeutes, avocats et avocates, etc.
- Site web : https://www.cabxl.be
- Numéro de téléphone : 02 552 24 14
- Adresse mail : ekram.elghzaoui@just.fgov.be
La mémoire traumatique, c’est quoi ?
La mémoire traumatique est un phénomène psychologique et neurobiologique où des événements particulièrement violents, tels que les violences sexuelles, sont stockés de manière dysfonctionnelle dans le cerveau. Contrairement à une mémoire classique, ces souvenirs ne sont pas intégrés de manière cohérente et restent figés, souvent associés à des émotions intenses comme la peur, la honte, ou la terreur. Lorsqu'un souvenir traumatique est réactivé, la personne peut revivre l'événement comme s'il se produisait à nouveau, avec les mêmes émotions et sensations physiques.
Comment la mémoire traumatique se manifeste-t-elle ?
La mémoire traumatique peut se manifester par des flashbacks, des cauchemars ou des réactions de panique déclenchées par des éléments rappelant l'agression. Ces souvenirs sont souvent fragmentés, désordonnés et peuvent ressurgir de manière inattendue. Ils plongent la personne dans un état de détresse intense. La mémoire traumatique rend difficile la verbalisation et l'intégration des expériences traumatiques, ce qui complique la guérison. Cela nécessite un accompagnement thérapeutique spécialisé pour aider la personne à désensibiliser ces souvenirs et à les intégrer dans son histoire de vie de manière moins douloureuse.

Législation
Ce que dit la loi
En Belgique, les violences sexuelles constituent des infractions graves, passibles d’amendes et/ou de peines de prisons
Cela concerne notamment :
- Le viol
- L’inceste
- L’atteinte à l’intégrité sexuelle
- Le voyeurisme
- La diffusion non consentie d’images ou vidéos à caractère sexuel
- Etc.
Qu’est-ce que la notion de consentement sexuel au regard de la loi ?
Le consentement doit être libre, éclairé et réversible.
- La personne doit le donner librement et il ne peut pas être déduit d’une simple absence de résistance : céder n'est pas consentir.
- Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.
- De plus, le consentement à un acte à caractère sexuel spécifique n’implique pas d’emblée le consentement à un autre acte. Par exemple, le stealthing, c’est-à-dire la poursuite d’un rapport sexuel après avoir retiré son préservatif sans le consentement de son ou sa partenaire, constitue bel et bien un viol.
Il n’y a pas de consentement si :
- La personne est dans une situation de vulnérabilité qui altère son libre arbitre et qui est due à :
- Un état de peur,
- L’influence de l’alcool, de drogues ou d’autres substances psychotropes,
- À une maladie ou à une situation de handicap.
- L’acte à caractère sexuel a eu lieu sous la menace, la violence physique ou psychologique, la surprise, la contrainte ou la ruse
- La personne est inconsciente ou endormie
- La relation a eu lieu en raison d’une situation d’autorité (médecin, enseignant, moniteur sportif, etc.)
- Les partenaires sont de la même famille au sens large ou cohabitants sauf s’ils sont tous les deux majeurs et consentants
- L’un des partenaires n’a pas 16 ans sauf à partir de 14 ans si la différence d'âge ne dépasse pas 3 ans.
Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)
Consulter le site des Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS)
Bon à savoir
Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/5 du nouveau Code pénal.
Le consentement sexuel des personnes mineures
En Belgique, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Ce qui veut dire que l’âge pour donner son consentement librement est fixé à 16 ans.
- En dessous de 14 ans : une relation sexuelle est toujours considérée comme un viol, qu’il y ait consentement ou non.
- Entre 14 ans et 16 ans : la loi prévoit que toute relation sexuelle d’une personne majeure avec un adolescent ou une adolescente dans cette tranche d’âge sera considérée comme un viol, sauf si l’écart d’âge entre les deux jeunes n’est pas supérieur à trois années et que les jeunes sont consentants
- À partir de 16 ans (majorité sexuelle) : un mineur peut légalement avoir des relations sexuelles, s’il y consent, avec un ou une jeune de 16 ans (ou plus) ou une personne adulte.
L’inceste est toujours interdit
La loi belge interdit l’inceste même si l’enfant ou l’adolescent dit être consentant (article 417/6 du Code pénal).
Il n’y a jamais de consentement valide lorsque :
- L’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui
- L’acte est rendu possible par une position d’autorité, de confiance ou d’influence
- L’acte est lié à une situation de prostitution ou de débauche
L’inceste sur mineur·e est imprescriptible : la victime peut porter plainte sans limite de temps.
Contenus à caractère sexuel
Selon l’article 417/49 du Code pénal, la réalisation, la possession et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel impliquant une personne de moins de 16 ans sont interdites, même si la personne est consentante.
Cela inclut :
- Les sextos ou nudes envoyés entre jeunes
- Les enregistrements partagés volontairement à un moment, mais utilisés ensuite sans consentement (revenge porn, diffusion sur les réseaux, etc.)
Ces actes sont considérés comme des infractions pénales.
Bon à savoir
Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/06 et 133 du nouveau code pénal.
Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)
Les infractions de base du Code pénal en matière de violences sexuelles
Le Code pénal belge prévoit différentes infractions et facteurs aggravants en matière de violences sexuelles (loi du 21 mars 2022).
Voici les infractions de base en matière de violences sexuelles.
- Viol : toute pénétration sexuelle sans consentement sur une personne ou à l’aide d’une personne. Cela inclut le viol à distance ou par l’auto-pénétration forcée.
- Atteinte à l’intégrité sexuelle : commettre des actes sexuels sur une personne sans son consentement ou la forcer à avoir des actes sexuels.
- Voyeurisme : observer ou enregistrer une personne dénudée ou ayant une activité sexuelle sans son consentement.
- Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel : montrer ou partager des images ou vidéos sexuelles d’une personne sans son accord. Cela concerne par exemple, le fait de diffuser du contenu pour se venger (« revenge porn »), pour « s’amuser » ou dans un but lucratif, et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel avec intention méchante ou dans un but lucratif.
Bon à savoir
Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/7 et suivants du Code pénal ainsi que 134 et suivants du nouveau Code pénal.
Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)
Les facteurs aggravants
Les facteurs aggravants sont des situations qui alourdissent la gravité d’une infraction et augmentent les peines encourues. Elles tiennent compte du contexte de l'acte, de la vulnérabilité des victimes ou de la violence utilisée. Voici les principaux facteurs aggravants :
- Les actes ayant entraîné la mort
- Les actes accompagnés ou précédés de torture, séquestration ou violence grave
- Les actes commis sous la menace d’une arme ou après l’administration de substances
- Les actes commis sur une personne en situation de vulnérabilité (femme enceinte, personne mineure, en situation de handicap…)
- Les actes commis sur un mineur
- L'inceste, c’est-à-dire tout acte à caractère sexuel (viol, atteinte à l’intégrité sexuelle, voyeurisme, etc) commis par un ou une membre de la famille sur une personne mineure. Par membre de la famille, on entend un parent, une personne alliée ascendante ou descendante jusqu’au 3ème degré, un partenaire, une personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. L’inceste sur une personne mineure est imprescriptible : cela signifie qu’on peut toujours porter plainte sans limite de temps.
- Les actes sexuels intrafamiliaux non consentis, c’est-à-dire tout acte à caractère sexuel (viol, atteinte à l’intégrité sexuelle, voyeurisme, etc) non consentis au sein de la famille. Par famille, on entend un parent, une personne alliée ascendante ou descendante jusqu’au 3ème degré, un ou une partenaire, une personne qui occupe une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.
- Les actes motivés par un mobile discriminatoire : actes sexuels non consentis ciblant une personne pour des raisons touchant à la race, le genre, la religion, la grossesse, le handicap, etc.
- Les actes commis par une personne en position d'autorité ou de confiance.
- Les actes commis avec l’aide ou en présence de plusieurs personnes.
Bon à savoir
Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/12 du Code pénal et 134 du nouveau Code pénal.
FAQ
Questions fréquentes
Oui. Les violences sexuelles sont malheureusement largement répandues.
N’importe quelle personne pourrait être victime de violences sexuelles mais les femmes et les filles sont touchées de manière beaucoup plus importante.
Environ 64 % de la population belge âgée de 16 à 69 ans a déjà subi une forme de violence sexuelle , allant du harcèlement sexuel à l'exploitation sexuelle. L’enquête réalisée en 2021 en Belgique indique qu’environ deux femmes sur cinq (19 %) et un homme sur cinq (5 %) ont été victime de viol.
On estime aussi que 2 à 3 enfants par classe subissent ou ont subi des violences sexuelles.
Certains groupes de la population (personnes racisées, en situation de handicap, LGBTQIA+, etc.) sont plus exposés aux violences, dont les violences sexuelles, car ils subissent des discriminations cumulées.
Selon les statistiques des Centres de Prévention des Violences sexuelles, 90% des victimes sont des femmes et 62% d’entre elles connaissent l’auteur des violences sexuelles.
Il est difficile de déterminer un chiffre précis avec exactitude, mais la littérature s’accorde à dire qu’il y a globalement moins de 2 % de fausses accusations pour agression sexuelle et viol. On estime que le taux de fausses déclarations pour agression sexuelle et viol est bien inférieur à celui des arnaques à l’assurance. En tant que professionnelle ou professionnel capable de faciliter le parcours d’une victime, il est donc essentiel de croire sa parole, jusqu’à preuve du contraire.
Oui, la grande majorité des agressions sexuelles sont commises par une personne connue de la victime. Contrairement à des stéréotypes répandus, les victimes sont plus rarement agressées par un inconnu dans la rue.
89 % des victimes qui appellent la ligne d’écoute de SOS viol ont été agressées par une personne qu’elles connaissaient. Les auteurs sont très majoritairement des hommes. Le HCE en France estime que les hommes sont auteurs de 91 % des violences sexistes.
Les violeurs sont des personnes « comme tout le monde ». Ils sont issus de tous les milieux sociaux. La plupart du temps le violeur est une personne que la victime connait et fréquente : voisin, ami, colocataire, parent, entraineur sportif, connaissance, collègue...
Les victimes et auteurs de violences sexuelles ont souvent un entourage et un environnement commun, ce qui rend difficile pour la victime d’en parler (peur de ne pas être crue, peur du rejet, de la culpabilité, de la honte, etc.).
Non. Malgré de nombreuses tentatives de classification et typologie des auteurs d’infraction à caractère sexuel, il n’existe aucun profil type ou unique. Les auteurs peuvent provenir de tous les milieux sociaux, économiques et culturels . Certaines variables structurelles, situationnelles et relatives au modus operandi doivent être prises en considération sans qu’ils puissent expliquer de façon isolée les conduites violentes sexuelles.
Le consentement constitue un élément déterminant de la violence sexuelle. Il est défini et central dans le nouveau Code pénal sexuel (Art 417/5).
Le consentement doit aussi répondre à plusieurs caractéristiques. Il doit être :
- libre : il ne peut pas être obtenu via la menace, la violence, la contrainte, la surprise ou la ruse
- éclairé : la personne doit être en état de consentir, de comprendre à quoi elle va consentir
- énoncé : le silence ne peut pas être interprété comme un oui
- révocable : il peut être retiré à tout moment
Enfin, il ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance…
Le consentement, c’est quand on communique clairement qu’on est d’accord d’avoir une relation sexuelle, d’avoir telle ou telle pratique sexuelle, d’ échanger telle photo intime de soi... Cet accord vaut pour un moment précis, une pratique précise. Le consentement peut être retiré à tout moment, même pendant l’acte sexuel. Il est tout à fait normal et OK de changer d’avis. On peut dire oui et puis ne plus avoir envie.
Par contre, déduire qu’il y a consentement simplement parce qu’une personne n’a pas résisté ou n’a pas dit clairement « non », ça on ne peut pas.
Le consentement est impossible si l’acte à caractère sexuel a été commis :
- en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime :
- si elle se trouve en situation de peur
- si elle est sous l’influence de l’alcool ou de toute autre substance qui altère la conscience
- si sa situation de handicap ou de maladie altère son libre arbitre
- à la suite d’une menace, de violences physiques ou psychologiques
- lorsque la personne est endormie ou inconsciente.
On ne peut pas déduire qu’une personne consent à un acte sexuel juste parce qu’elle ne dit pas non ou qu’elle ne dit rien du tout. Le consentement sexuel doit rencontrer 5 caractéristiques :
- Il doit être donné librement : pour donner son consentement de manière valable, il faut être dans des conditions qui le permettent. Être saoule ou sous l’emprise de substances ne permet pas de donner son accord librement. Lorsqu’une personne dort ou est inconsciente, elle ne peut pas donner son consentement. Si on est sous la menace ou si on est forcée (chantage ou peur de représailles en cas de refus), il n’y a pas de consentement possible.
Il n’y a jamais de consentement possible pour un ou une mineure de moins de 16 ans ni pour certaines personnes n’ayant pas la capacité mentale de consentir. C’est le cas pour certains niveaux de handicap mental, par exemple. - Il doit être éclairé : cela signifie que le consentement ne vaut que si on sait ce qu’on partage. Si l’un des partenaires ment ou dissimule délibérément certaines intentions, il n’y a pas de consentement. Par exemple, retirer un préservatif de manière dissimulée alors qu’on prévoyait un rapport protégé c’est un viol.
- Il doit être spécifique : consentir à une pratique intime ou sexuelle comme par exemple à des baisers ne veut pas dire que l’on consent automatiquement à d’autres pratiques comme toucher les seins.
- Il doit être réversible : être d’accord un jour n’implique pas qu’on donne son consentement pour toutes les fois suivantes. Même pendant une relation sexuelle, on est libre de s’arrêter à tout moment sans devoir donner aucune justification. Si le ou la partenaire manifeste son mécontentement et tente de faire changer d’avis, le consentement n’est plus donné librement.
- Il doit être clair et enthousiaste : la question est de savoir si une personne dit « oui » ou donne activement son consentement, de diverses manières, verbales ou non. Il est important que le consentement soit exprimé de façon claire avec des paroles, des gestes ou les deux. Le silence et le fait de ne pas résister physiquement ne signifie pas qu’il y a un consentement.
Un doute ? Il est important de s’arrêter et de vérifier auprès de sa ou de son partenaire, par exemple en lui demandant simplement si elle ou il a envie de continuer à partager ces échanges sexuels ou si elle ou il préfère autre chose. Le doute persiste ? Il faut s’arrêter !
Les données statistiques montrent que les violences sexuelles sont très courantes. On estime que 2 à 3 enfants par classe , filles et garçons, ont subi des violences sexuelles. En Belgique, l’étude de l’Université de Gand montre que 64 % de la population résidant en Belgique, âgée entre 16 et 69 ans, a vécu de la violence sexuelle (81 % de femmes et 48 % d’hommes).
Les violences ont des effets sur le long terme, dans toutes les sphères de la vie de la victime. En France, on estime que les coûts liés à aux violences sexuelles dans l’enfance se chiffrent à 9,7 milliards d’euros. Il s’agit donc d’un problème majeur, tant sociétal que de santé publique.
Vu l’ampleur de cette problématique et le nombre de cas, c’est-à-dire sa prévalence, on pourrait dire que la société en fait encore beaucoup trop peu pour lutter contre les violences sexuelles.
Organismes
Services professionnels
Womando
Espace Chrysalide
Ressources
Outils de référence
Témoignages
Elles et ils témoignent...
Formations